
Dremmwel Breizh
Horizons Bretons



Au XVIe siècle, afin de réduire les révoltes populaire et de rassurer l’opinion publique, des contrôles de boulangerie se mettent en place. Ordre est également donné de laisser le client peser lui-même le pain qu’il achète, sur une balance installée à la fenêtre ou dans l’endroit le plus clair de la boutique.
Les pains doivent avoir la blancheur et le poids exigés par les règlements. De plus, ils doivent porter la marque du boulanger. En cas de faute grave, on pouvait confisquer tous les biens du boulanger et lui retirer son droit d’exercer.
L’ordonnance du 13 mai 1569 prescrit aux compagnons boulangers d’être continuellement en chemise, en caleçon, et en bonnet, « dans un costume tel qu’ils fussent toujours en état de travailler et jamais sortir, hormis les dimanches et les jours de chômage réglés par les statuts ».
Par ailleurs, ils n’ont pas le droit de se rassembler, de porter épée, dague ou bâton, de porter manteau, chapeau et haut de chausses, sauf les jours de fêtes, mais uniquement de drap gris et blanc, sous peine de prison.
Aux XVIIème et XVIIIème siècles, durant les émeutes de subsistance, "la fureur est au pain" et la police se range du côté des commerçants qui protègent leurs boutiques des pillages du peuple. Il arrive alors que les voleurs de pains soient pendus.
Mais souvent, lors d'une révolte, le premier pendu était le boulanger, accusé d'être la cause du manque de nourriture. Fallait qu’ils aiment le pain ou qu’ils soient fous pour vouloir être boulanger !
Au XVIIe siècle, le marché des céréales et du pain s’organise. Ce siècle voit la naissance des sciences agronomiques. On observe en France un essor de l’aménagement des sols. Parallèlement les villes grandissent. Les pouvoirs publiques cherchent alors à faire des réservent de blé, en prévision des famines ou des sièges. L’agriculture de subsistance se transforme en une agriculture de marché.

Pour la boulangerie aussi, le XVIIe siècle apporte un nouvel essor. L’usage de la levure est autorisé définitivement. Les farines sont de plus en plus blanches, ce qui améliore la fabrication et la qualité, ainsi qu’une diversification de variété de pain.
Le pain, jusqu’alors rond, prend des formes.
A la ville.
A partir de 1635, le boulanger doit cuire journellement quatres sortes de pains dans sa boutique :
- le pain de Chailly de 12 onces (1 once = 30,594 gr) apres cuisson.
- Le pain de chapitre de 10 onces.
- Le pain bourgeois ou bis-blanc de 16 onces
- Le pain bis ou pain de brode de 14 onces
Les balances et les poids doivent rester dans la boutique. On défend aux boulangers d’exposer les autres pains de luxe : Pain de Gonesse, Pain à la reine etc qui ne sont vendus qu’aux seuls clients qui en font expressément la demande.

A la campagne.
Le paysan panifie ce qui est à sa disposition, c’est-à-dire toutes sortes de céréales, voire toutes sortes de graines (légumes ou fruits secs). Le terme « pain » renvoie à de nombreuses variétés de produits panifiés. Seule constante, ces pains restent gros et on les consomme rassis.
« En bonne maison pain rassis et bois sec » dit le dicton.
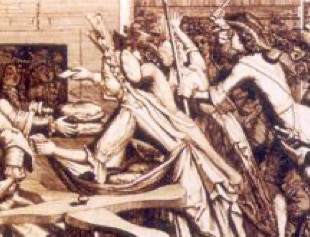
Au XVIIIe siècle, pour les Français, le pain n’est pas seulement un aliment de base. Il symbolise le sacré, l’espoir, la justice, la stabilité… Il rassure quand il est blanc et inquiète quand il devient noir et vient à manquer.
Même si les autres denrées ne manquent pas, « le gros du peuple croit mourir de faim s’il n’a point de pain » précise-t-on dans l’encyclopédie méthodique (1782).
« Lors des disettes, (…) on s’ingéniait à faire entrer dans la pâte à pain toutes les substances possible, car on avait beau distribuer du riz et des soupes, le peuple voulait du pain ». (Le blé, la farine et le pain / Dr A. Gottschalk, 1935)
Le roi de France redoute les soulèvements populaires pour manque de pain. Pour résoudre et atténuer les crises, l’état constitue des stocks propres à enrayer toute famine. Il légifère de plus en plus la commercialisation des grains.
Les académies organisent des concours. Les savants s’acharnent à trouver de nouvelles solutions. Parmentier propose l’utilisation de la pomme de terre dans le pain.
Rien y fait, le peuple gronde toujours et réclame du pain. En France, il n'a jamais été aussi cher depuis le début du siècle. Au sein du peuple, la révolte se prépare.
Finalement, en 1793, on arrive au pain pour tous : riches et pauvres, le pain de l’égalité. Hélas, la condition des boulangers devient parallèlement misérable, en raison des brimades des administrations révolutionnaires. Seuls les boulangers forains semblent s’en tirer à moindre mal.

Le pain est essentiel pour les Français et le souverain indispensable à sa distribution. En cas de pénurie, c'est à lui d'intervenir.
Mais l'économie de subsistance est fragile, sujette à disettes. Si le pain manque, n'est-ce pas la faute du souverain qui serait passé du mauvais côté, du côté des affameurs ? Peu à peu, le soupçon gagne.
Le pacte entre le roi nourricier et le peuple inquiet a commencé de se rompre bien avant la Révolution. Laquelle n'a pu que relever le rôle que le souverain ne pouvait plus tenir. L'administration des grains, c'est une affaire de longue durée dans l'histoire française.
Les femmes de la Halle de Paris qui avaient pris l'initiative d'aller chercher le roi à Versailles ont eu gain de cause. La tête couronnée de lauriers elles crient "Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron !" (Musée de l'histoire vivante de Montreuil)

Crédits photos : Toutes les photographies de ce site sont la propriété de « lbdeb.free.fr » . Pour toute utilisation, merci d'en faire la demande par mail à lbdeb@free.fr et aucune utilisation à but commercial ne sera acceptée .
Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google. Google utilise les données recueillies pour suivre et examiner l'utilisation de ce site, préparer des rapports sur ses activités et les partager avec d'autres services Google.
Google peut utiliser les données recueillies pour contextualiser et personnaliser les annonces de son propre réseau de publicité.
Données personnelles recueillies: données de cookies et d'utilisation. Lieu de traitement: États-Unis. Trouver ici la politique de confidentialité de Google.
Ce site web utilise les cookies. Veuillez consulter notre politique de confidentialité pour plus de détails.
Refuser
OK